Voici dans son intégralité une petite histoire tirée de la Semaine de Suzette n°12 de la 22e année (22 avril 1926). Le texte est signé V. d’Entrevaux et les dessins sont de Raymond de la Nézière, illustrateur très présent dans la Semaine de Suzette d’avant-guerre.
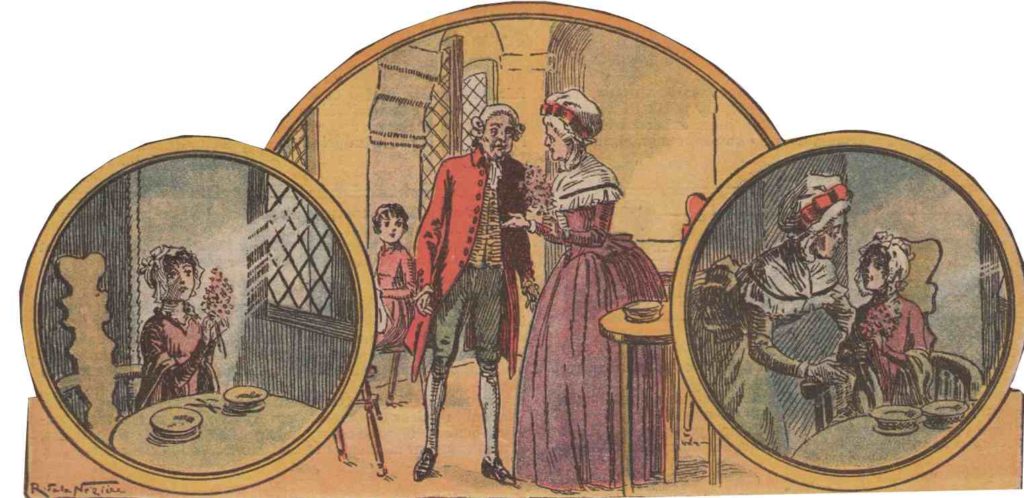
DANS une petite ville d’Allemagne, vivait, en 1802, une famille d’émigrés français. Comme beaucoup de leurs compatriotes, ils avaient dû tenir jadis un rang élevé dans leur pays. Obligés de fuir à l’étranger, on ne reconnaissait l’ancienneté de leur race qu’à une perfection de manières, inconnue des rudes Germains. Il y avait donc, dans une toute petite maison sur les bords de la Brenz, un vieux grand-père qui peignait des dessus de boîtes en miniature, une grand-mère s’évertuant, sans perdre sa distinction charmante, à de multiples travaux, et une petite fille, Joséphine qui passait des jours paisibles à tirer l’aiguille en face de son aïeule.
 Grand-mère avait une adresse de fée. Elle inventait de jolis ouvrages de doigts qui faisaient les délices des belles dames du pays et mettaient un peu d’aisance dans le modeste intérieur. Joséphine, ayant quitté la France toute petite, avait un souvenir confus des splendeurs passées. Ses grands-parents ne lui en parlaient jamais. A quoi bon ? Dans ce bouleversement infernal, jamais la pauvre petite ne retrouverait le rang perdu. Elle devrait se contenter d’une existence modeste, bien heureuse de se sentir en sécurité.
Grand-mère avait une adresse de fée. Elle inventait de jolis ouvrages de doigts qui faisaient les délices des belles dames du pays et mettaient un peu d’aisance dans le modeste intérieur. Joséphine, ayant quitté la France toute petite, avait un souvenir confus des splendeurs passées. Ses grands-parents ne lui en parlaient jamais. A quoi bon ? Dans ce bouleversement infernal, jamais la pauvre petite ne retrouverait le rang perdu. Elle devrait se contenter d’une existence modeste, bien heureuse de se sentir en sécurité.
Le père de Joséphine était mort, son frère cadet parti avec Lafayette, au moment de la guerre de l’Indépendance, avait dû périr au passage de la Delaware, car depuis, personne n’avait su ce qu’il était devenu. L’antique maison de Bourlenc allait donc s’éteindre. Le vieux comte, maintenant qu’il employait son talent de peintre à gagner sa vie, avait renoncé à tous titres et à sa particule. Personne ne se doutait quelle riche héritière l’enfant modestement vêtue eût été autrefois.
Quelques années se passèrent ainsi. Joséphine grandissait. Parmi les blondes Allemandes, ses yeux de flamme et ses cheveux noirs faisaient sensation.
Mais, un jour, le grand-père, tout à fait vieux, ne vit plus assez clair pour son travail délicat. La comtesse perdait l’agilité de ses doigts, créateurs de tant de jolies frivolités. Les fleurs en coquilles délicatement teintées, si appréciées des dames, ne sortaient plus comme par enchantement de ses pauvres mains.
 — Si j’essayais de remplacer bonne-maman, songeait Joséphine, elle ne réussit plus comme autrefois. Bon-papa aurait besoin d’un nouvel habit. Comment faire ? Oh ! si j’étais plus grande, si je pouvais leur rendre ce qu’ils m’ont donné… Elle tourna et retourna mille et mille projets dans sa petite tête de dix ans. Le lendemain, ayant remis de l’ordre dans le salon, préparé le couvert du déjeuner et appris ses leçons, elle vînt gentiment câliner sa grand-mère et la prier de lui permettre de l’aider à transformer les précieuses coquilles en pavots ou en marguerites.
— Si j’essayais de remplacer bonne-maman, songeait Joséphine, elle ne réussit plus comme autrefois. Bon-papa aurait besoin d’un nouvel habit. Comment faire ? Oh ! si j’étais plus grande, si je pouvais leur rendre ce qu’ils m’ont donné… Elle tourna et retourna mille et mille projets dans sa petite tête de dix ans. Le lendemain, ayant remis de l’ordre dans le salon, préparé le couvert du déjeuner et appris ses leçons, elle vînt gentiment câliner sa grand-mère et la prier de lui permettre de l’aider à transformer les précieuses coquilles en pavots ou en marguerites.
– Non. ma mie, fit l’aïeule souriante. Tu es trop petite encore, pas assez habile. Tu gâterais mes matériaux, et j’ai tant de peine à m’en procurer ! Va jouer avec ton amie Frederika. Elle te mènera promener avec sa gouvernante. Tu as besoin de distraction, pauvre petite ! Joséphine eut beau supplier, implorer, rien n’y fit. elle fut donc obliger d’aller jouer avec sa voisine, la petite d’un conseiller intime, lourde fillette de son âge qui s’appliquait à combler sa compagne de café au lait et de tartes aux fruits, convaincue qu’un chagrin ne pouvait résister à un bon repas.
Au retour, Joséphine se montra gaie et rieuse. Ses grands-parents en étaient réjouis. Et, la soirée terminée, chacun regagna sa chambre. Dès que bonne maman fut endormie, Joséphine se leva sans bruit, s’habilla à tâtons et gagna le salon. Il faisait un clair de lune superbe. Inutile d’allumer la lampe ! Joséphine, le cœur battant, s’installa devant la table ronde et commença à travailler.
— Jamais bonne-maman ne pourra se tirer de cette grande branche de Lilas, songeait-elle, ses yeux sont si fatigués! J’ai très bien vu comment il faut s’y prendre. En trois nuits, j’aurai terminé. Sûrement, cette belle corbeille de fleurs de toutes sortes vaudra beaucoup d’argent, et grand-père aura un habit neuf.
Elle travailla, la pauvre petite, malgré le sommeil qui l’écrasait. Le lendemain, la vieille dame, trouvant son ouvrage avancé, fut un peu surprise. Sans doute avait-elle travaillé plus qu’elle ne le croyait. Le jour suivant, même remarque. Elle fit part de son étonnement à son mari. Il avoua n’y rien comprendre. Joséphine, présente à l’entretien, perdait contenance. Pour masquer son émotion, elle s’enfonça dans sa leçon d’histoire sainte.
— C’est étonnant, disait grand-mère, je suis sûre que ma branche était moins touffue hier ! Ma mémoire baisse sans doute. Qui donc a touché à mon ouvrage?
 Quel ennui ! pensait Joséphine à part elle. Grand’mère va tout deviner. Cependant je dois achever ma tâche, cette nuit. Après, je ferai ma confession.
Quel ennui ! pensait Joséphine à part elle. Grand’mère va tout deviner. Cependant je dois achever ma tâche, cette nuit. Après, je ferai ma confession.
La vieille dame eut peut-être un soupçon, mais elle n’en dit rien. La soirée s’acheva comme à l’ordinaire. Une fois ses parents endormis, Joséphine retourna bien vite à sa besogne. Elle travaillait de tout sou cœur, si appliquée qu’elle n’entendit point marcher derrière elle. Deux bras l’entourèrent, et la voix de bonne-maman murmura : Ma chérie ! C’était donc toi?
— Oh! grand’mère, vous m’avez fait peur ! Vous n’êtes pas fâchée, n’est-ce pas? C’était si amusant de travailler en cachette! Je voulais vous montrer que je suis assez grande pour vous aider. Vous me permettrez désormais de faire des fleurs avec vous, n’est-ce pas? Voyez comme la corbeille est belle, à présent. Sûrement le marchand de la Kœnigstrasse l’achètera fort cher : je sais que la maman de Frederika a une envie folle de posséder un surtout comme celui-ci. Avec votre gain, ou pourra acheter un habit neuf à bon-papa pour sa fête.
L’aïeul, réveillé, vint à son tour admirer l’ouvrage de sa bonne petite-fille. Il avait des larmes aux yeux en l’embrassant et en la remerciant tout bas.
Deux jours après, la superbe corbeille de fleurs de coquillages était vendue. Joséphine obtint la permission d’inviter sa petite amie à goûter. Bonne-maman fit un gâteau français, bien meilleur que les tartes allemandes. Les petites filles y joignirent des fraises des bois et des cerises de la Forêt Noire. Elles bavardaient gaiement lorsque, tout à coup, la porte s’ouvrit. Un inconnu qui ressemblait à M. de Bourlenc, entra dans la pièce.
Mon fils! s’écria la grand’mère suffoquée de joie, en pressant l’arrivant contre son cœur. C’était le compagnon de Lafayette. Echappé par miracle à la mort, il avait pu enfin revenir d’Amérique. Il avait vainement cherché ses parents en France et, les croyant massacrés pendant la Terreur, il allait, désespéré, s’en retourner aux Etats-Unis, quand, voyageant on Allemagne, il avait par hasard retrouvé leur trace. Il était chez le marchand de la Kœnigstrasse, et admirait un surtout de fleurs en coquilles qui lui rappelait un ouvrage en honneur à cette époque dans le midi de la France. Il voulut l’acheter lorsque la conseillère intime von Z, la mère de Frederika, déclara qu’elle venait d’en faire l’emplette.
Le marchant, pour tout concilier, apprit que cette corbeille était l’œuvre d’une dame française, Mme Bourlenc, qui consentirait certainement à en refaire une semblable.  Au nom de sa famille,
Au nom de sa famille, 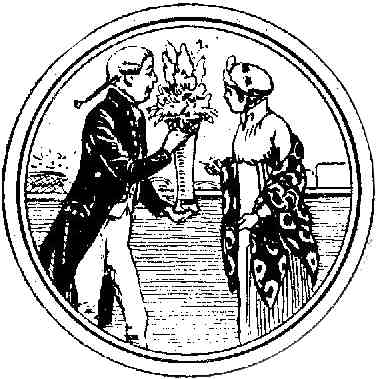 l’étranger, éperdu, demanda aussitôt l’adresse de ces Français. Il déclina son nom et ses titres, et la bonne conseillère, enchantée de tenir un rôle dans un pareil roman, s’offrit à emmener le jeune homme dans sa voiture, chez la petite amie de sa fille. La branche de lilas de Joséphine avait permis la réunion des pauvres exilés. La conseillère eut l’attention délicate d’offrir sur-le-champ l’ouvrage de sa nièce à l’oncle d’Amérique : le don fut accepté avec joie, et la soirée se termina au milieu de la félicité universelle. Grâce à de puissantes protections, la famille de Bourlenc put rentrer en France; Joséphine grandit, devint une belle jeune fille, et se maria, le jour de ses dix-huit ans. Et depuis ce temps-là, leurs petits-enfants admirent, précieusement conservée dans une vitrine, au milieu de bibelots anciens, l’ouvrage de la petite émigrée : la belle branche de lilas.
l’étranger, éperdu, demanda aussitôt l’adresse de ces Français. Il déclina son nom et ses titres, et la bonne conseillère, enchantée de tenir un rôle dans un pareil roman, s’offrit à emmener le jeune homme dans sa voiture, chez la petite amie de sa fille. La branche de lilas de Joséphine avait permis la réunion des pauvres exilés. La conseillère eut l’attention délicate d’offrir sur-le-champ l’ouvrage de sa nièce à l’oncle d’Amérique : le don fut accepté avec joie, et la soirée se termina au milieu de la félicité universelle. Grâce à de puissantes protections, la famille de Bourlenc put rentrer en France; Joséphine grandit, devint une belle jeune fille, et se maria, le jour de ses dix-huit ans. Et depuis ce temps-là, leurs petits-enfants admirent, précieusement conservée dans une vitrine, au milieu de bibelots anciens, l’ouvrage de la petite émigrée : la belle branche de lilas.

